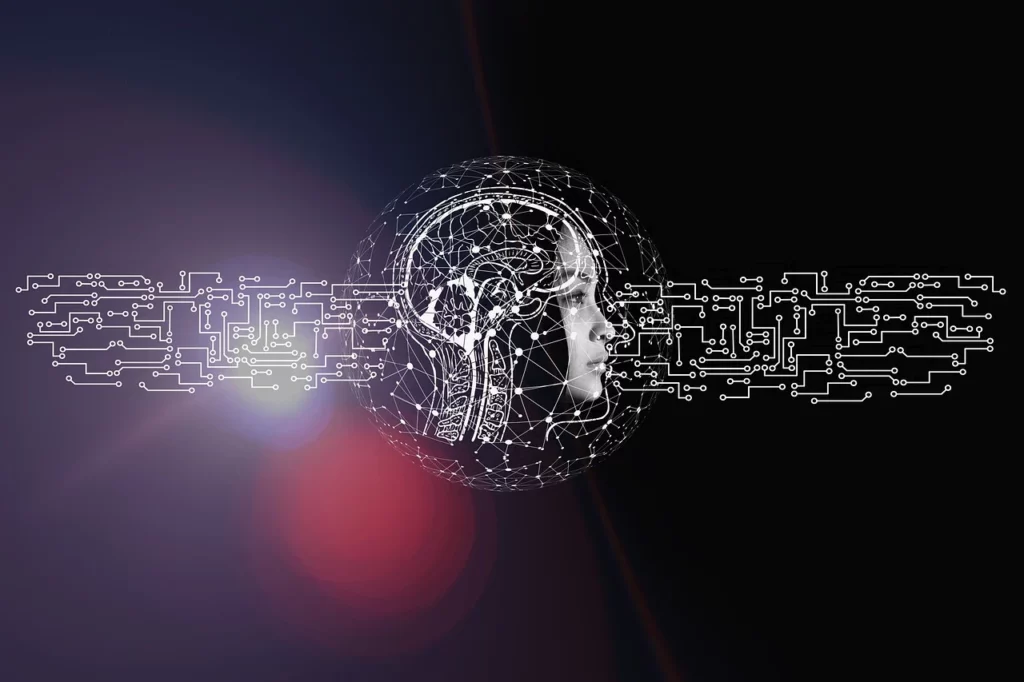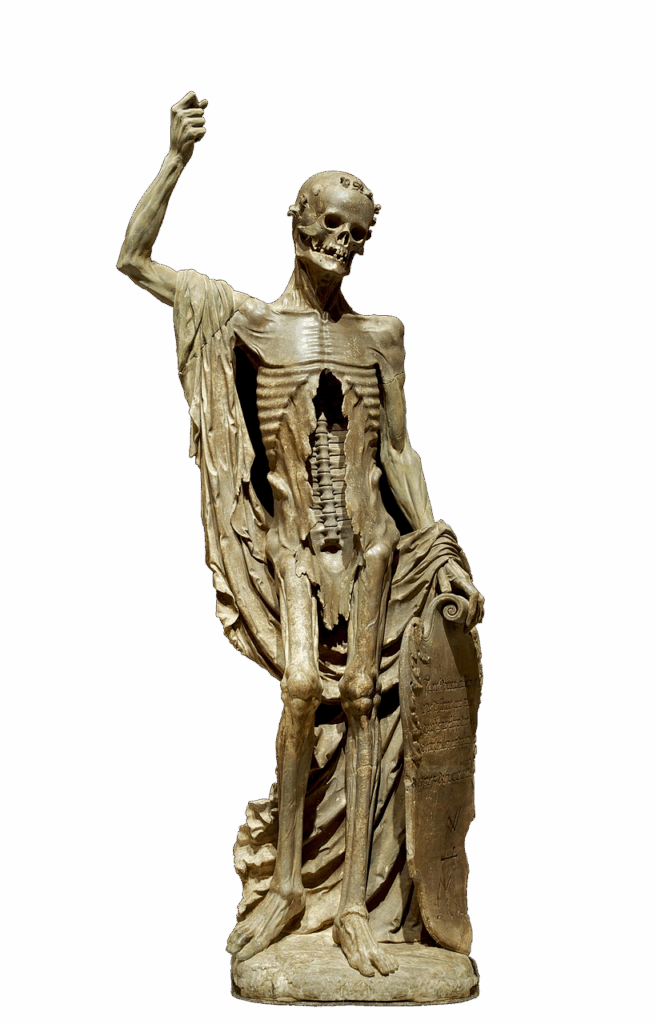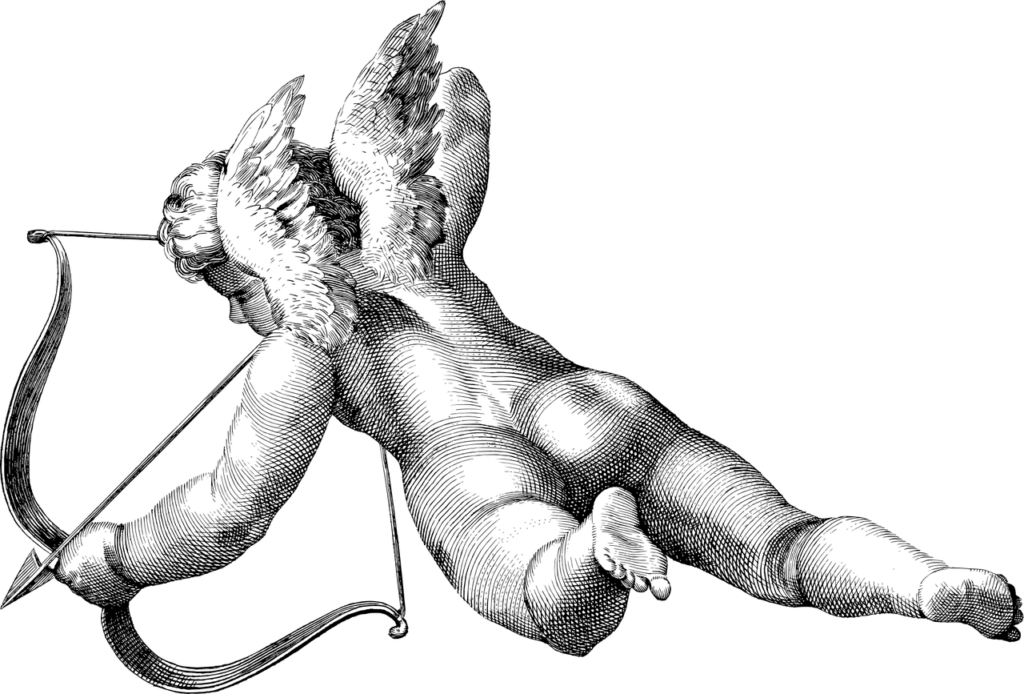La Bouffée Délirante Aiguë Polymorphe (BDAP) est un épisode psychotique soudain, intense et généralement transitoire. Elle survient parfois chez des personnes jusque-là sans antécédents psychiatriques, et marque une rupture radicale dans la continuité du vécu psychique. Bien que souvent spectaculaire, elle bénéficie d’un bon pronostic lorsqu’elle est prise en charge rapidement.
Qu’est-ce qu’une bouffée délirante aiguë polymorphe ?
La BDAP fait partie des troubles psychotiques aigus et transitoires décrits dans la CIM-10 et la CIM-11. Son apparition est brutale : en quelques heures ou en quelques jours, la personne développe un délire polymorphe, c’est-à-dire changeant, multiforme, passant d’une thématique à une autre sans logique apparente. Les hallucinations peuvent être auditives, visuelles ou corporelles, et les émotions fluctuent de manière extrême : euphorie, angoisse, confusion, sidération.
L’épisode s’inscrit dans un tableau très instable : ce que la personne affirme au matin peut s’être transformé radicalement le soir. Cette grande variabilité, associée à l’absence d’antécédents psychotiques, aide à différencier la BDAP d’autres troubles comme la schizophrénie ou les troubles bipolaires.

À qui cela arrive-t-il ?
La BDAP survient le plus souvent chez des jeunes adultes, même si tous les âges peuvent être concernés. Elle apparaît fréquemment dans un contexte de stress aigu, de bouleversement de vie ou d’épuisement psychique. Les facteurs déclenchants peuvent être un deuil, une rupture, une situation de pression professionnelle, un isolement, une migration ou un événement vécu comme écrasant.
Ce trouble ne résulte pas d’une faiblesse de caractère : il est plutôt la rencontre entre une vulnérabilité individuelle, souvent invisible, et un événement de vie dépassant les capacités d’adaptation habituelles.
Comment se manifestent les symptômes ?
L’un des aspects les plus caractéristiques est la rupture nette avec le réel. La personne adhère à des croyances délirantes mouvantes : se sentir surveillée, investie d’une mission, persuadée que des messages lui sont adressés, ou convaincue que son corps se transforme.
À ces convictions s’ajoutent une agitation ou, au contraire, un retrait intense. La pensée devient difficile à suivre, parfois décousue. L’émotion est amplifiée et instable : une joie intense peut laisser place en quelques heures à une terreur profonde.
Pour l’entourage, la situation peut être incompréhensible et très anxiogène. L’individu semble tout à coup « ne plus être lui-même », alors que, de son point de vue, ce qu’il vit est d’une évidence absolue.
Comprendre les causes : une rencontre entre stress et vulnérabilité
Aucune cause unique ne permet d’expliquer la BDAP. Les recherches mettent en avant une combinaison de facteurs biologiques (hypersensibilité dopaminergique), psychologiques (vulnérabilité émotionnelle, stress chronique) et contextuels (événements de vie intenses).
Souvent, l’épisode survient après des semaines ou des mois d’épuisement intérieur, parfois passé inaperçu. La bouffée délirante apparaît alors comme une rupture brutale dans une trajectoire déjà fragilisée, même si la personne ne s’en rendait pas compte avant l’épisode.
Cas clinique fictif : L’histoire de Camille, 27 ans
Camille, 27 ans, travaille depuis deux ans dans une start-up en pleine expansion. Les horaires sont instables, la charge de travail importante, et une restructuration récente a entraîné la suppression de plusieurs postes. Dans le même temps, Camille se sépare de son compagnon avec qui elle partageait un appartement. Elle dort peu, mange moins, s’isole davantage.
Un soir, après plusieurs jours de grande fatigue, Camille croit entendre des voix venant de l’appartement voisin. Ces voix semblent commenter ses actions. D’abord inquiète, elle pense ensuite qu’on tente de lui transmettre un message important. Le lendemain, convaincue d’avoir un rôle essentiel à jouer, elle se met à déambuler dans la rue, persuadée que des signes lui sont adressés.
Son comportement attire l’attention de passants qui alertent les secours. Aux urgences psychiatriques, Camille explique ressentir une « évidence » : elle serait chargée de protéger la ville d’un danger imminent. Quelques heures plus tard, cette conviction s’efface pour laisser place à une peur extrême d’être surveillée par une organisation secrète.
Après plusieurs jours d’hospitalisation et un traitement antipsychotique léger, Camille retrouve progressivement son ancrage dans le réel. Elle raconte ensuite s’être sentie « submergée par quelque chose de trop fort ». Un suivi psychothérapeutique l’aide à comprendre l’impact du stress prolongé, l’épuisement silencieux qui a précédé l’épisode et les signaux d’alerte pour prévenir une éventuelle récidive.
Comment se déroule la prise en charge ?
Dans la majorité des cas, le premier enjeu est la sécurisation. L’hospitalisation peut être nécessaire si la personne est confuse, agitée ou en danger. Un traitement antipsychotique est mis en place, souvent à faible dose et pour une durée limitée.
Une fois la phase aiguë passée, l’accompagnement psychothérapeutique prend toute son importance. Il permet à la personne de donner sens à ce qui s’est produit, de travailler sur les facteurs déclenchants et de restaurer ses capacités d’autorégulation émotionnelle.
L’entourage, souvent bouleversé par la soudaineté de l’épisode, bénéficie également d’informations et de soutien pour comprendre ce qu’il s’est passé.
Quel pronostic ?
Contrairement à d’autres troubles psychotiques, la bouffée délirante aiguë polymorphe présente souvent un pronostic favorable : la rémission est généralement complète. Cependant, un suivi reste nécessaire, car une partie des patients peut présenter un nouvel épisode ou évoluer vers un trouble de l’humeur ou, plus rarement, vers une schizophrénie.
Un accompagnement régulier, une bonne hygiène de vie psychique, et une prise en compte des signaux précoces de stress constituent les meilleurs outils de prévention.
Références théoriques
- Ey, H., Bernard, P., & Brisset, C. (1974). Manuel de psychiatrie. Masson.
- Gaillard, R. (2018). Psychiatrie clinique. Elsevier Masson.
- Pichot, P. (1995). Les états psychotiques aigus. Paris : PUF.
- Organisation Mondiale de la Santé (CIM-10 & CIM-11). Troubles psychotiques aigus et transitoires.
- Haute Autorité de Santé (HAS). Premiers épisodes psychotiques : recommandations de bonnes pratiques.